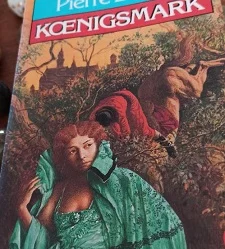Signs and wonders (Signes et merveilles) est le titre d’un recueil de nouvelles de John Davys Beresford publié en 1921, ainsi que le titre précis d’une des nouvelles, « Signes et merveilles », entre science-fiction et fantastique, dans laquelle le narrateur se retrouve brusquement sur une autre planète. Beresford est un auteur anglais de la première moitié du XXème siècle, marqué par l’influence d’H. G. Wells, salué en son temps par George Orwell ou encore Virginia Woolf, et lui-même influence pour un autre britannique, Olaf Stapledon. La nouvelle « Signes et merveilles » montre en outre son intérêt pour la théosophie, forme de recherche spirituelle entre religion et occultisme dont la figure de référence est Helena Blavatsky. Engagé politiquement plutôt à gauche, Beresford y glisse aussi des allusions à la société de classes anglaise.
Je propose ci-dessous une traduction personnelle de la nouvelle, suivie de quelques notes, d’un bref commentaire et du texte anglais.
Signes et merveilles
Je rêvai ceci dans la grisaille d’une journée de février, à Londres.
J’avais médité sur les éléments qui participent à la construction de l’entité humaine, et plus particulièrement sur ce nouvel aspect de la théorie du corps éthérique qui le présente comme une forme de matière visible, pondérable, tangible, hautement organisé, mais à peine perceptible, à un point presque incroyable. De là j’en vins à considérer la possibilité d’une certaine essence encore plus éloignée de notre conception de la substance grossière de notre expérience objective ; puis, pour un moment, je caressai l’idée de l’imperceptible transition de cette matière en dispersion à la pensée ou à la pulsion — des corps divers, éthérique, astral, mental, ou bouddhique, à l’Âme libre et absolue.
Je suppose que je m’endormis à ce moment. Je ne m’aperçus d’aucune altération de ma conscience, mais je ne puis expliquer autrement le fait qu’en un instant je fus transporté d’un endroit dégagé du nord de Londres, et de toutes choses familières de notre terre, à quelque planète où l’on ne savait rien des habitants du système solaire.
Ce changement extraordinaire s’accomplit sans le moindre choc. Il était, en effet, imperceptible. Le monde nouveau sur lequel j’ouvris les yeux paraissait au premier regard ne différait en rien de particulier de celui que j’avais quitté si récemment. Je vis au-dessous de moi une réplique parfaite d’Hampstead Garden Suburb. Le vent soufflait de l’est sans avoir perdu de sa qualité spécifique. Les passants occasionnels avaient le même air d’appréhension lasse et d’intense préoccupation concernant la pitoyable importance de leur vie immédiate, qui m’avait semblé, ces dernières semaines, caractéristique des classes moyennes. De plus, me dis-je, il commençait à pleuvoir.
Je frissonnai et décidai que je ferais tout aussi bien de rentrer chez moi. J’avais le sentiment qu’il ne valait pas la peine de franchir une distance qui ne pouvait se mesurer en miles terrestres pour simplement répéter mes expériences terrestres. Puis, par hasard, peut-être pour vérifier ma théorie selon quoi il allait certainement pleuvoir, je levai les yeux et compris tout à coup la différence inexprimable entre ce monde et le nôtre.
Car sur notre petite terre à nous, le ciel ne requiert pas notre attention. Il a parfois ses effets de nuage et de lumière, et ceux-ci éveillent de temps à autre l’intérêt du poète ou de l’artiste. Mais pour nous, gens ordinaires, le ciel est toujours à peu près le même, et nous ne le regardons que lorsque nous nous attendons à la pluie. Même alors, souvent nous fermons les yeux.
Dans cet autre monde qui tourne autour d’un soleil si lointain que sa lumière n’a pas encore atteint notre terre, le ciel est tout à fait différent. Il s’y passe des choses. Par exemple, comme je levais la tête, je vis une grande porte ouverte, d’où sortait une immense procession qui traînait sa glorieuse étendue à travers la pleine largeur des cieux. Je n’entendais aucun son. L’ost éternel se déplaçait dans une silencieuse dignité, du zénith à l’horizon. Puis, une fois que la procession fut passée, la totalité visible de la voûte céleste s’écarta comme un rideau et là, par l’ouverture, se mit à regarder ce qui avait la semblance d’un œil immense et attentif.
Mais ce qui succéda immédiatement au regard fixe de ce guetteur écrasant, je l’ignore, car quelqu’un me toucha le bras, et une voix près de mon épaule dit, avec les accents caractéristiques d’un Cockney terrien :
« Qu’est-ce que tu reluques, chef ? Des coucous ? J’en vois aucun. »
Je me tournai vers lui, pour constater qu’il s’agissait d’un oisif tel qu’on en voit chaque jour à Londres.
“Des avions ? dis-je en retour. Dieu du ciel, ne voyez-vous pas ce qu’il y a là-haut ? La procession, et cet œil ?”
Alors il leva la tête, ainsi que moi, et l’œil avait disparu ; mais entre les cieux encore écartés je pus distinguer la profondeur d’un espace si riche en beautés et, à ce qu’il semblait, en promesses, que je retins mon souffle par pur émerveillement.
“Non ! Je vois rien de rien, chef,” répondit mon compagnon.
Or donc je présume que, tandis qu’il parlait, je dus être tiré de mon rêve, car la gloire s’évanouit, et je me retrouvai à donner une petite aumône à un misérable qui se présentait comme en proie à des souffrances injustes, dont il n’était en rien responsable.
Alors que je rentrais à pied sous la pluie, je me fis la réflexion que les habitants de ce monde incroyablement lointain, marchant, ainsi qu’ils font toujours, le regard tourné vers le sol, sont vraisemblablement incapables de voir les signes et merveilles qui flamboient à travers le ciel. Comme nous-mêmes, ils sont trop préoccupés par la pitoyable importance de leur vie immédiate.

Notes :
– « corps divers, éthérique, astral, mental, ou bouddhique » : Beresford puise ici dans l’occultisme, évoquant des « corps subtils » qui ne peuvent être perçus que grâce à des capacités exceptionnelles ;
– Hampstead Garden Suburb : quartier bourgeois du nord Londres, fruit d’un plan d’urbanisation de 1906 : il s’agit donc d’un quartier récent à l’époque où Beresford écrit sa nouvelle ;
– Cockney : désigne alors un Londonien de la classe ouvrière, parlant un argot spécifique ; on trouve des personnages de Cockneys chez Dickens, notamment, ou encore chez Georges Bernard Shaw (Pygmalion), contemporain de Beresford, dont il a dit du bien ; il n’y a guère de façon satisfaisante de traduire un accent ou de l’argot, je ne propose ici qu’un compromis modeste.
Commentaire
L’expression « Signs and wonders » renvoie en anglais à l’Ancien Testament, où l’on peut lire : « I will multiply my signs and wonders » (New Revised Standard Version Bible, 1989), ce que la traduction française de Louis Segond rend par : « je multiplierai mes signes et mes miracles » (Exode 7.3). Dans les années 1900, l’expression anglaise est popularisée par le mouvement « le Réveil d’Azusa Street », qui prend naissance à Los Angeles et est mené par le pasteur afro-américain Wiliam J. Seymour. Après 1915, le mouvement initial s’affaiblit, mais contribue à l’émergence du pentecôtisme.
Il est difficile de savoir si Beresford a en tête ce qui s’est passé aux États-Unis quand il écrit Signes et merveilles, même si, travaillant pour divers journaux anglais d’ampleur internationale, il a pu avoir accès à l’information. Il est certain par contre qu’il connaît la source de l’expression et sa dimension spirituelle, étant donné son intérêt pour l’occultisme.
On peut d’ailleurs s’amuser à remarquer que son narrateur-personnage, qui ironise au sujet des artistes et de leur perception du monde, peut difficilement passer pour une personne « ordinaire » aux yeux du lecteur après un paragraphe qui a fait la part belle au mysticisme ! Ainsi s’ouvre une double possibilité d’interprétation : soit le narrateur est un occultiste aux perceptions extrasensorielle (ce qui, pour Beresford, relève bien du possible, et donc de la science-fiction !), soit il rêve tout simplement, solution conventionnelle du récit fantastique. Narration à la première personne, imagerie cosmique, autre monde, sciences occultes, importance du rêve (éveillé)… Les amateurs de Lovecraft ne seront pas perdus !
Beresford glisse ici également une touche sociale. Ainsi, il choisit comme cadre Hampstead Garden Suburb, quartier alors récent de Londres, sorti de terre par la volonté d’un couple de grands bourgeois philanthropes, Samuel et Henrietta Barnett. Le narrateur-personnage, entre diverses considérations philosophico-mystiques, prend le temps de faire des observations au sujet de l’air « caractéristique des classes moyennes », commentant leur rapport à « leur vie immédiate », observation suffisamment importante pour être répétée et appliquée à la société de l’autre planète ! Une morale donc se dégage : quel que soit le contexte, même le plus favorable en apparence à l’émerveillement, les mœurs et les critères sociaux s’appliquent.
Le texte prend ainsi une dimension satirique, que suggérait déjà l’apparition du Cockney, personnage type de la classe ouvrière. Le narrateur voit d’abord en lui un » loafer », en anglais, c’est-à-dire littéralement un paresseux, et donc, un mendiant. Il pousse son mépris de classe jusqu’à ironiser sur les souffrances du Cockney, à qui il fait cependant l’aumône. Or, ce mendiant est bien le seul qui a essayé de voir ! S’il échoue, privilégiant une cause rationnelle (merveille technique des premiers avions !) à une cause extraordinaire, cela le rend tout de même plus proche de l’occultiste et même des artistes. Lui du moins cherche à s’émerveiller ! D’ailleurs le narrateur n’a fait qu’entrevoir, sans contrôle sur son déplacement onirique, et doit bien se résoudre finalement à affronter la pluie, et la routine.

SIGNS & WONDERS
I DREAMED this in the dullness of a February day in London.
I had been pondering the elements that go to the making of the human entity, and more particularly that new aspect of the theory of the etheric body which presents it as a visible, ponderable, tangible, highly organised, but almost incredibly tenuous, form of matter. From that I slid to the consideration of the possibility of some essence still more remote from our conception of the gross material of our objective experience; and then for a moment I held the idea of the imperceptible transition from this ultimately dispersing matter to thought or impulse—from the various bodies, etheric, astral, mental, causal, or Buddhistic, to the free and absolute Soul.
I suppose that at this point I fell asleep. I was not aware of any change of consciousness, but I cannot otherwise explain the fact that in an instant I was transported from an open place in the North of London, and from all this familiar earth of ours, to some planet without the knowledge of the dwellers in the solar system.
This amazing change was accomplished without the least shock. It was, indeed, imperceptible. The new world upon which I opened my eyes appeared at first sight to differ in no particular from that I had so recently left. I saw below me a perfect replica of the Hampstead Garden Suburb. The wind blew from the east with no loss of its characteristic quality. The occasional people who passed had the same air of tired foreboding and intense preoccupation with the miserable importance of their instant lives, that has seemed to me to mark the air of the middle-classes for the past few weeks. Also it was, I thought, beginning to rain.
I shivered and decided that I might as well go home. I felt that it was not worth while to travel a distance unrecordable in any measure of earthly miles, only to renew my terrestrial experiences. And then, by an accident, possibly to verify my theory that it was certainly going to rain, I looked up and realised at once the unspeakable difference between that world and our own.
For on this little earth of ours the sky makes no claim on our attention. It has its effects of cloud and light occasionally, and these effects no doubt may engage at times the interest of the poet or the artist. But to us, ordinary people, the sky is always pretty much the same, and we only look at it when we are expecting rain. Even then we often shut our eyes.
In that other world which revolves round a sun so distant that the light of it has not yet reached the earth the sky is quite different. Things happen in it. As I looked up, for instance, I saw a great door open, and out of it there marched an immense procession that trailed its glorious length across the whole width of heaven. I heard no sound. The eternal host moved in silent dignity from zenith to horizon. And after the procession had passed the whole visible arch of the sky was parted like a curtain and there looked out from the opening the semblance of a vast, intent eye.
But what immediately followed the gaze of that overwhelming watcher I do not know, for someone touched my arm, and a voice close at my shoulder said in the very tones of an earthly cockney:
“What yer starin’ at, guv’nor? Airyplanes? I can’t see none.”
I looked at him and found that he was just such a loafer as one may see any day in London.
“Aeroplanes,” I repeated. “Great Heaven, can’t you see what’s up there? The procession and that eye?”
He stared up then, and I with him, and the eye had gone; but between the still parted heavens I could see into the profundity of a space so rich with beauty and, as it seemed, with promise, that I held my breath in sheer wonder.
“No! I can’t see nothin’, guv’nor,” my companion said.
And I presume that as he spoke I must have waked from my dream, for the glory vanished and I found myself dispensing a small alms to a shabby man who was representing himself as most unworthily suffering through no fault of his own.
As I walked home through the rain I reflected that the people of that incredibly distant world, walking, as they always do, with their gaze bent upon the ground, are probably unable to see the signs and wonders that blaze across the sky. They, like ourselves, are so preoccupied with the miserable importance of their instant lives.