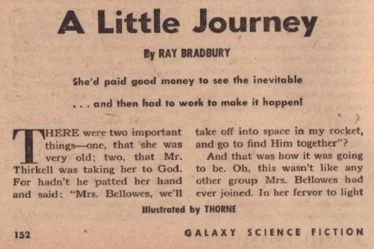« An inhabitant of Carcosa » (« Un habitant de Carcosa ») est une nouvelle fameuse d’Ambrose Bierce. Fameuse ? Elle l’est sans doute moins, en France, que le mot même de Carcosa auquel il est régulièrement fait référence dans des textes fantastiques et dans la pop culture, du jeu de rôle à la musique métal. Robert W. Chambers et H. P. Lovecraft ont contribué à cette aura. Mais il y a bien à l’origine une brève nouvelle, publiée en 1886 dans un journal californien : une histoire d’homme perdu, à la recherche de ses souvenirs et d’une ville… Le lecteur intrigué trouvera ci-dessous des traductions personnelles de la nouvelle de Bierce et d’un poème de Richard L. Tierney, qui pourront être amendées, suivies d’un commentaire et des textes anglais (américain).

Un habitant de Carcosa
Puisqu’il est différentes variétés de mort — certaines où le corps demeure ; et certaines où, l’esprit l’accompagnant, il disparaît. Ceci survient communément dans la seule solitude (telle est la volonté de Dieu) et, nul ne contemplant la fin, nous affirmons que l’homme est perdu, ou parti pour un long voyage — ce qu’en effet il est ; parfois cependant cela se produit à la vue du grand nombre, comme d’abondants témoignages le montrent. En une sorte particulière de mort l’esprit tout aussi bien meurt, ceci alors que le corps lui demeurait vigoureux des années durant, la chose est connue. Parfois, ainsi en est-il véritablement attesté, il meurt avec le corps, mais après une saison il se dresse de nouveau à l’endroit où le cadavre s’est bel et bien décomposé.
Alors que je méditais ces paroles de Hali (qu’il repose en Dieu) et m’interrogeais sur leur pleine signification, comme quelqu’un qui, ayant une intuition, doute encore qu’il n’y ait quelque chose derrière, autre que celle qu’il a discernée, je ne m’aperçus point de l’endroit où je m’étais égaré jusqu’à ce qu’un soudain vent frais, me heurtant le visage, ne ravivât en moi quelque perception des environs. Je constatai ébahi que toutes choses m’apparaissaient inconnues. De toutes parts s’étirait l’étendue d’une plaine désolée et sinistre, recouverte d’une vaste profusion d’herbage flétri, qui bruissait et sifflait dans le vent d’automne avec Dieu sait quelle mystérieuse et troublante insinuation. Saillant au-dessus à longs intervalles, des roches aux sombres teintes et aux formes étranges, qui semblaient en intelligence les unes avec les autres et échanger des regards lourds d’un sens dérangeant, comme si elles avaient dressé la tête pour observer l’issue de quelque événement anticipé. Ici et là se montrait une poignée d’arbres chenus, tels des meneurs parmi cette malveillante conspiration d’expectative silencieuse.
Le jour, pensai-je, doit être bien avancé, bien que le soleil fût invisible ; et quoique sensible au fait que l’air fût pur et glacé ma conscience de cela était plus mentale que physique — je ne ressentais aucune sensation d’inconfort. Au-dessus de ce morne paysage une voûte de nuages bas, couleur de plomb, restait suspendue ainsi qu’une malédiction manifeste. En tout ceci se trouvaient une menace et un présage — une trace de malice, une suggestion de désastre. Il n’y avait nul oiseau, bête ou insecte. Le vent soupirait dans les branches dénudées des arbres morts et l’herbe grise ployait pour chuchoter son affreux secret à la terre ; mais aucun autre son ni mouvement n’interrompaient le terrible repos de ce lugubre endroit.
Je remarquai dans les herbes certaines pierres usées par les intempéries, auxquelles des outils avaient à l’évidence donné forme. Elles étaient brisées, recouvertes de mousse et à demi englouties dans la terre. Certaines gisaient, prostrées, d’autres penchaient selon divers angles, nulle n’était verticale. Assurément, il s’agissait de pierres tombales, même si les tombes elles-mêmes n’existaient plus sous forme de monticules ou de creux ; les années avaient tout aplani. Dispersées çà et là, d’autres dalles massives indiquaient où quelque pompeux tombeau ou monument ambitieux avait jadis lancé son défi à l’oubli. Si vieilles paraissaient ces reliques, si anciens ces vestiges de la vanité et ce mémorial de la tendresse et de la piété, si bosselés, usés et souillés — si négligé, abandonné et oublié l’endroit, que malgré moi je me figurais le premier à découvrir le cimetière d’une race d’hommes préhistoriques dont le nom même avait depuis longtemps disparu.
Emplis de ces pensées, je restais un moment sans intérêt pour l’enchaînement de mes propres mésaventures, mais bientôt je songeai : « Comment suis-je arrivé là ? » La réflexion d’un instant sembla éclaircir tout cela et expliquer par la même occasion, quoique d’une façon troublante, la singularité avec laquelle mon imagination avait investi la totalité de ce que j’avais vu ou entendu. J’étais malade. Je me souvenais à présent que j’étais demeuré prostré par la faute d’une fièvre soudaine, que ma famille m’avait rapporté que lors de mes phases de délire je n’avais cessé de réclamer à cor et à cri de l’air et de la liberté, et que l’on m’avait gardé au lit pour prévenir ma fuite hors les murs. À cette heure, j’avais échappé à la vigilance de mes gardiens et je m’étais aventuré en direction de — d’où donc ? J’étais incapable de présomption. Il était clair que je me trouvais à une distance considérable de la ville où je demeurais — l’antique et fameuse cité de Carcosa.
Nul signe de vie humaine n’était visible ni audible, où que ce fût ; nulle fumée s’élevant, ni aboiement de chien de garde, ni beuglement du bétail, ni cris d’enfants durant leurs jeux — rien d’autre que ce cimetière lugubre, à l’air de mystère et d’effroi, conséquence de ma propre cervelle déséquilibrée. N’étais-je pas de nouveau en proie au délire, désormais au-delà des soins de l’homme ? Tout n’était-il pas une illusion, fruit de ma folie ? J’appelais tout haut les noms de mes femmes et de mes fils, cherchais leurs mains de mes mains tendues, cependant même que je déambulais parmi les pierres croulantes et dans les herbages flétris.
Un bruit derrière moi me fit me retourner. Un animal sauvage — un lynx — approchait. La pensée me vint : si je m’effondre ici, dans le désert — si la fièvre revient et que je défaille, cette bête me sautera à la gorge. Je bondis vers elle en poussant un cri. Elle trotta paisiblement, à moins d’une paumée de moi, avant de disparaître derrière un rocher.
Un instant après une tête d’homme parut monter du sol, à une courte distance de là. Il montait le flanc le plus éloigné d’une colline basse dont la crête se distinguait mal du nivellement alentour. Bientôt sa silhouette entière fut visible sur fond de nuée grise. Il avançait à demi nu, à demi revêtu de peaux. Sa chevelure était hirsute, sa barbe longue et mal taillée. D’une main, il tenait un arc et une flèche ; l’autre brandissait une torche flamboyante qui laissait derrière elle une longue traînée de fumée noire. Il marchait lentement et prudemment, comme s’il craignait de tomber dans quelque tombe ouverte, dissimulée par l’herbe haute. Cette étrange apparition me surprit sans m’alarmer, et suivant un trajet qui dût l’intercepter je fis sa rencontre face-à-face, l’abordant avec la salutation habituelle : « Dieu vous garde. »
Il n’en tint aucun compte, ni ne ralentit le pas.
Je persévérai : « Aimable étranger, je suis souffrant et égaré. Indiquez-moi, je vous en prie, le chemin de Carcosa. »
L’homme se mit à entonner une mélopée barbare en une langue inconnue, s’en allant jusqu’à disparaître pour de bon.
Un hibou sur la branche d’un arbre mort poussa un hululement sinistre, auquel un autre répondit dans le lointain. Levant la tête, j’aperçus, par une trouée dans les nuages, Aldébaran et les Hyades ! En tout ceci se distinguait une impression de nuit — le lynx, l’homme à la torche, le hibou. Or je voyais — je discernais même les étoiles en l’absence des ténèbres. Je voyais, mais apparemment sans être vu ni entendu. Sous l’influence de quel sortilège subsistais-je tant bien que mal ?
Je pris place entre les racines d’un grand arbre, afin d’envisager sérieusement ce qu’il y avait de mieux à faire. De ma folie je ne doutais plus du tout, néanmoins je décelais dans ma certitude le fondement d’un doute. Je ne montrais aucun signe de fièvre. En outre, j’éprouvais une sensation d’euphorie et de vitalité qui m’était tout à fait étrangère — un sentiment d’exaltation physique et morale. Mes sens paraissaient fort vifs ; je pouvais sentir l’air ainsi qu’une substance pesante ; je pouvais entendre le silence.
Une racine énorme de l’arbre gigantesque contre le tronc duquel je m’appuyais, comme j’étais assis, renfermait une dalle de pierre dans son étreinte, dont un morceau pénétrait dans un renfoncement formé par une autre racine. Ainsi la pierre était-elle en partie protégée du mauvais temps, quoique fortement dégradée. Ses bords étaient arrondis par l’usure, ses coins tout rongés, sa surface parcourue de profonds sillons et de motifs en écaille. De brillantes particules de mica se voyaient dans la terre alentour — vestiges de sa décomposition. Cette pierre en apparence avait indiqué la tombe d’où l’arbre avait surgi, des lustres auparavant. Les racines accaparantes de l’arbre avaient pillé la tombe et emprisonné la pierre.
Une bourrasque soudaine repoussa des feuilles mortes et des brindilles du côté le plus élevé de la pierre ; je découvris les lettres en bas-relief d’une inscription et me penchai pour la lire. Ciel ! mon nom complet ! — ma date de naissance ! — la date de ma mort !
Un rayon de lumière horizontal illumina tout le flanc de l’arbre tandis que je bondissais sur mes pieds. Le soleil se levait à l’est rosé. Je me tenais entre son vaste disque rouge et l’arbre — nulle ombre n’obscurcissait le tronc !
Les hurlements d’un chœur de loups salua l’aube. Je les vis assis sur leur arrière-train, séparément ou par groupes, au sommet de monticules irréguliers et de tumulus qui emplissaient pour moitié ma perspective désertique, et s’étendaient jusqu’à l’horizon. Alors je compris qu’il s’agissait là des ruines de l’antique et fameuse cité de Carcosa.
——————————————————————————————————————–
Tels sont les faits communiqués au médium Bayrolles par l’esprit Hoseid Alar Robardin.
Pour en lire plus :
Les amateurs pourront lire ma traduction de poèmes de Lovecraft, dont son recueil Fungi de Yuggoth, dans lequel un poème rend hommage à Bierce, dans la collection poésie des éditions Points (parution mars 2024), à commander par exemple ici :
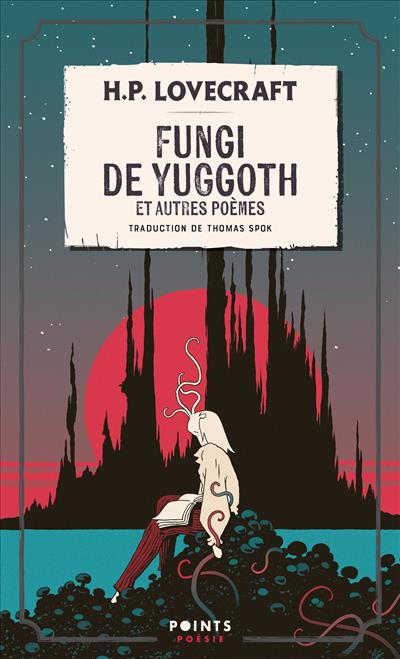
Commentaire
La nouvelle « An inhabitant of Carcosa » de Bierce a été publiée le 25 décembre 1886 dans le San Francisco Newsletter, où l’auteur avait ses habitudes (il y publie dès 1868), puis elle est intégrée au recueil Tales of Soldiers and Civilians (1891-92, à San Francisco), et toujours du vivant de l’auteur au recueil Can Such Things Be? (1893, à New York), les rééditions et le passage d’une côte à l’autre montrant assez le succès de l’œuvre.
La romancière Marion Zimmer Bradley a formulé l’hypothèse que le mot Carcosa aurait été forgé à partir de Carcassonne, la cité médiévale française (qui inspirera aussi Dunsany pour sa nouvelle du même nom, en 1910). L’étymologie va dans ce sens, avec la forme latine Carcaso (selon Pline l’Ancien).
Le nom du prophète « Hali » serait quant à lui une version latine du nom de Khalid ibn Yazid, prince de la dynastie des Omeyyades, peut-être alchimiste, mais à qui il est difficile d’attribuer clairement une œuvre. Il est possible que le Hali de Bierce soit une source d’inspiration pour Abdul Alhazred dont Lovecraft fait l’auteur du Necronomicon.
C’est sans doute d’abord par le nom de Carcosa que la nouvelle est entrée dans l’imagination collective, ou en tout cas a pu imprégner un pan du fantastique et de la popculture : dès 1895, c’est Robert W. Chambers qui l’emprunte pour son propre recueil de nouvelles, The King in Yellow (Le Roi en jaune), dont le succès marque à son tour les esprits au point que divers auteurs vont s’approprier le mot Carcosa, en faisant parfois une ville, parfois un personnage, parfois une chanson, et même tout à fait autre chose…
Citons, sans exhaustivité :
– l’auteur Karl Edgar Wagner fondant en 1973 la maison d’édition Carcosa, dédiée au pulp ;
– George R. R. Martin nommant Carcosa une ville du Trône de fer ;
– Alan Moore, reprenant des motifs lovecraftiens dans son scénario du comic book Neonomicon, avec un personnage étrange de dealer nommé Johnny Carcosa ;
– la série télé True Detective, scénarisée par Nick Pizzolatto, dont la saison 1 montrait les détectives Rust Cohle et Marty Hart confrontés à une secte d’adorateurs du « Yellow King », dont le temple horrible se nommait Carcosa et évoquait également des thèmes lovecrafiens ;
– une résidence à Kuala Lumpur bâtie en 1898, en Malaisie, dont le nom Carcosa (Seri Negara) fut choisi par le représentant anglais Frank Swettenham, d’après la nouvelle, pensant que Carcosa était un mot-valise venu de l’italien, « cara » et « casa », pour désigner une « demeure désirable » ;
– différents groupes et chanteurs, comme les Belges d’Ancient Rites (l’album Dim Carcosa en 2001), les Américains de High on Fire (la deuxième chanson de l’album Lumineferous, 2015), le rappeur suédois Yung Lean (« I’ll be your Yellowman Carcosa land » chante-t-il dans son album Stranger, 2017).

Lovecraft, bien sûr, était un admirateur d’Ambrose Bierce et de Robert W. Chambers. Dans son récit The Whisperer in Darkness (Celui qui chuchotait dans les ténèbres, 1931), il évoque le lac de Hali, le Signe jaune, Hastur, Aldébaran… les mêlant à sa propre mythologie : « I found myself faced by names and terms that I had heard elsewhere in the most hideous of connections—Yuggoth, Great Cthulhu, Tsathoggua, YogSothoth, R’lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Yian, Leng, the Lake of Hali, Bethmoora, the Yellow Sign, L’mur-Kathulos, Bran, and the Magnum Innominandum—and was drawn back through nameless aeons and inconceivable dimensions to worlds of elder, outer entity at which the crazed author of the Necronomicon had only guessed in the vaguest way. »
[Je me trouvais confronté à des noms et des termes que j’avais entendu ailleurs, liés de la façon la plus abominable — Yuggoth, le grand Cthulhu, Tsathoggua, YogSothoth, R’lyeh, Nyarlathotep, Azathoth, Hastur, Yian, Leng, le lac de Hali, Bethmoora, le Signe jaune, L’mur-Kathulos, Bran, et le Magnum Innominandum — et fus attiré de nouveau à travers les éons innommés et les dimensions inconcevables vers des mondes d’entités extérieures, plus anciennes, que l’auteur forcené du Necronomicon n’avait fait qu’apercevoir, de la plus vague des façons.]
Mentionnons pour conclure le poème de Richard L. Tierney. Il y fait référence à Hastur et Cassilda, d’après Le Roi en jaune de Chambers, aux constellations qu’on trouvait déjà dans le texte de Bierce. Notons qu’il choisit la forme du sonnet, ce qui n’est pas sans rappeler ceux des Fungi de Yuggoth de Lovecraft. J’en propose ici une traduction rapide :
Carcosa
Je devine, lors des soirées d’hiver cristallines,
Quand des constellations brillent entre les branchages noirs des arbres,
Une étoile noire comme la nuit que nul observateur terrestre ne peut voir,
À quoi tient quelque effroi, par malveillance.
Nulle carte du ciel ne l’indique — non — mais le sommeil apporte
Sa vision depuis les Hyades assemblées —
Des eaux noires au-dessus desquelles une brise pesante
Pousse la chanson triste de la défunte Cassilda.
Nulle vision plus sombre n’accueille le dormeur que celle
Du lac, d’où se déversent les rouleaux de nuages ondés
Pour se briser sur la longue grève basaltique
Sous les rayons de la rouge Aldébaran —
Le lac d’où s’échappent les rêveurs, pris d’une terreur innommable,
Alors qu’Hastur se lève de son lit visqueux.

Les textes originaux
Carcosa
I sense, on crystal winter evenings
When constellations gleam through black-branched trees,
A night-dark star no earthly gazer sees
To which some dread malevolently clings.
No star-chart shows it —no— yet slumber brings
Its vision from the clustered Hyades—
Black waters over which a leaden breeze
Wafts the sad song that dead Cassilda sings.
No darker vision greets the sleeper than
That lake, from which the coiling cloud-waves pour
To break upon the long basaltic shore
Beneath the rays of red Aldebaran—
The lake whence dreamers flee in nameless dread
As Hastur rises from his slimy bed.
AN INHABITANT OF CARCOSA
For there be divers sorts of death—some wherein the body remaineth; and in some it vanisheth quite away with the spirit. This commonly occurreth only in solitude (such is God’s will) and, none seeing the end, we say the man is lost, or gone on a long journey—which indeed he hath; but sometimes it hath happened in sight of many, as abundant testimony showeth. In one kind of death the spirit also dieth, and this it hath been known to do while yet the body was in vigor for many years. Sometimes, as is veritably attested, it dieth with the body, but after a season is raised up again in that place where the body did decay.
PONDERING these words of Hali (whom God rest) and questioning their full meaning, as one who, having an intimation, yet doubts if there be not something behind, other than that which he has discerned, I noted not whither I had strayed until a sudden chill wind striking my face revived in me a sense of my surroundings. I observed with astonishment that everything seemed unfamiliar. On every side of me stretched a bleak and desolate expanse of plain, covered with a tall overgrowth of sere grass, which rustled and whistled in the autumn wind with heaven knows what mysterious and disquieting suggestion. Protruded at long intervals above it, stood strangely shaped and somber-colored rocks, which seemed to have an understanding with one another and to exchange looks of uncomfortable significance, as if they had reared their heads to watch the issue of some foreseen event. A few blasted trees here and there appeared as leaders in this malevolent conspiracy of silent expectation.
The day, I thought, must be far advanced, though the sun was invisible; and although sensible that the air was raw and chill my consciousness of that fact was rather mental than physical—I had no feeling of discomfort. Over all the dismal landscape a canopy of low, lead-colored clouds hung like a visible curse. In all this there were a menace and a portent—a hint of evil, an intimation of doom. Bird, beast, or insect there was none. The wind sighed in the bare branches of the dead trees and the gray grass bent to whisper its dread secret to the earth; but no other sound nor motion broke the awful repose of that dismal place.
I observed in the herbage a number of weather-worn stones, evidently shaped with tools. They were broken, covered with moss and half sunken in the earth. Some lay prostrate, some leaned at various angles, none was vertical. They were obviously headstones of graves, though the graves themselves no longer existed as either mounds or depressions; the years had leveled all. Scattered here and there, more massive blocks showed where some pompous tomb or ambitious monument had once flung its feeble defiance at oblivion. So old seemed these relics, these vestiges of vanity and memorials of affection and piety, so battered and worn and stained—so neglected, deserted, forgotten the place, that I could not help thinking myself the discoverer of the burial-ground of a prehistoric race of men whose very name was long extinct.
Filled with these reflections, I was for some time heedless of the sequence of my own experiences, but soon I thought, « How came I hither? » A moment’s reflection seemed to make this all clear and explain at the same time, though in a disquieting way, the singular character with which my fancy had invested all that I saw or heard. I was ill. I remembered now that I had been prostrated by a sudden fever, and that my family had told me that in my periods of delirium I had constantly cried out for liberty and air, and had been held in bed to prevent my escape out-of-doors. Now I had eluded the vigilance of my attendants and had wandered hither to—to where? I could not conjecture. Clearly I was at a considerable distance from the city where I dwelt—the ancient and famous city of Carcosa.
No signs of human life were anywhere visible nor audible; no rising smoke, no watchdog’s bark, no lowing of cattle, no shouts of children at play—nothing but that dismal burial-place, with its air of mystery and dread, due to my own disordered brain. Was I not becoming again delirious, there beyond human aid? Was it not indeed all an illusion of my madness? I called aloud the names of my wives and sons, reached out my hands in search of theirs, even as I walked among the crumbling stones and in the withered grass.
A noise behind me caused me to turn about. A wild animal—a lynx—was approaching. The thought came to me: If I break down here in the desert—if the fever return and I fail, this beast will be at my throat. I sprang toward it, shouting. It trotted tranquilly by within a hand’s breadth of me and disappeared behind a rock.
A moment later a man’s head appeared to rise out of the ground a short distance away. He was ascending the farther slope of a low hill whose crest was hardly to be distinguished from the general level. His whole figure soon came into view against the background of gray cloud. He was half naked, half clad in skins. His hair was unkempt, his beard long and ragged. In one hand he carried a bow and arrow; the other held a blazing torch with a long trail of black smoke. He walked slowly and with caution, as if he feared falling into some open grave concealed by the tall grass. This strange apparition surprised but did not alarm, and taking such a course as to intercept him I met him almost face to face, accosting him with the familiar salutation, « God keep you. »
He gave no heed, nor did he arrest his pace.
« Good stranger, » I continued, « I am ill and lost. Direct me, I beseech you, to Carcosa. »
The man broke into a barbarous chant in an unknown tongue, passing on and away.
An owl on the branch of a decayed tree hooted dismally and was answered by another in the distance. Looking upward, I saw through a sudden rift in the clouds Aldebaran and the Hyades! In all this there was a hint of night—the lynx, the man with the torch, the owl. Yet I saw—I saw even the stars in absence of the darkness. I saw, but was apparently not seen nor heard. Under what awful spell did I exist?
I seated myself at the root of a great tree, seriously to consider what it were best to do. That I was mad I could no longer doubt, yet recognized a ground of doubt in the conviction. Of fever I had no trace. I had, withal, a sense of exhilaration and vigor altogether unknown to me—a feeling of mental and physical exaltation. My senses seemed all alert; I could feel the air as a ponderous substance; I could hear the silence.
A great root of the giant tree against whose trunk I leaned as I sat held inclosed in its grasp a slab of stone, a part of which protruded into a recess formed by another root. The stone was thus partly protected from the weather, though greatly decomposed. Its edges were worn round, its corners eaten away, its surface deeply furrowed and scaled. Glittering particles of mica were visible in the earth about it—vestiges of its decomposition. This stone had apparently marked the grave out of which the tree had sprung ages ago. The tree’s exacting roots had robbed the grave and made the stone a prisoner.
A sudden wind pushed some dry leaves and twigs from the uppermost face of the stone; I saw the low-relief letters of an inscription and bent to read it. God in Heaven! my name in full!—the date of my birth!—the date of my death!
A level shaft of light illuminated the whole side of the tree as I sprang to my feet in terror. The sun was rising in the rosy east. I stood between the tree and his broad red disk—no shadow darkened the trunk!
A chorus of howling wolves saluted the dawn. I saw them sitting on their haunches, singly and in groups, on the summits of irregular mounds and tumuli filling a half of my desert prospect and extending to the horizon. And then I knew that these were ruins of the ancient and famous city of Carcosa.
——————————————————————————————————————–
Such are the facts imparted to the medium Bayrolles by the spirit Hoseib Alar Robardin.