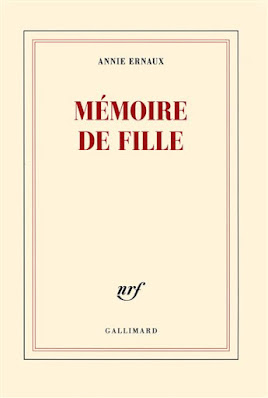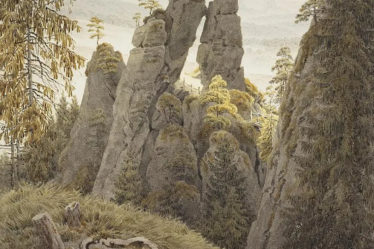Le viol dans Mémoire de Fille d’Annie Ernaux
Cette entrée en matière est certes quelque peu abrupte, et c’est bien là le but d’un article, vous interpeller et vous donner envie d’aller plus loin et de découvrir ce qui se cache derrière un titre…. Toutefois, je vous ai vu hésiter un peu en terminant l’accroche « selon Annie Ernaux ». Cette auteure est loin de faire l’unanimité, du moins du côté des lecteurs, car la critique, elle, reste toujours dithyrambique. Pourquoi ? Eh bien, parce que ses livres, m’a-t-on dit, ne sont pas toujours passionnants voire même, je cite, « un peu chiants » selon certains.
Pour ma part, je dois vous avouer que je n’avais jamais lu Annie Ernaux jusqu’à ce que je débarque en Erasmus et que notre professeur de littérature française nous demande de choisir, parmi un programme de lecture, un livre qui raconte la honte. Dans la liste, il y avait Mémoire de fille, j’ai vite lu la quatrième de couverture et comme il était question de première fois avec un garçon, je me suis dit que cela pouvait être croustillant. Mal m’en a pris, j’allais assister à un viol littéraire.
Couverture de l’édition folio/poche.
Mémoire de fille, un livre inclassable en même temps qu’un projet littéraire et social
Comme la plupart des œuvres d’Annie Ernaux, Mémoire de fille est inclassable. C’est de la littérature blanche, certes, mais à part cela difficile de bien cerner le genre littéraire auquel ce livre appartient. L’avantage d’être publié dans la collection Blanche c’est qu’on échappe justement à toute critique et qu’on n’a pas besoin de se poser ce genre de questions… La maison d’édition devient elle-même un gage de qualité littéraire, le tampon Gallimard c’est l’assurance d’être lu par l’intelligentsia parisienne et les jurys du Prix Goncourt, mais je ne voudrais pas m’aventurer davantage sur les chemins tortueux de la polémique Galligrasseuil, éternel panthéon éditorial, et préfère réserver mon encre pour un futur article.
Couverture de l’édition Gallimard, collection Blanche.
Mémoire de fille, ce n’est donc ni une autobiographie, ni un roman, ni un essai, ni même un bout de Journal intime, quoique… on s’en rapproche. Selon Isabelle Charpentier, professeure de sociologie à l’Université d’Amiens et spécialiste d’Annie Ernaux, cette dernière aurait toujours eu à cœur de trouver la forme la plus juste possible pour exprimer sa réflexion indissociablement littéraire, sociale et politique, inventant ainsi elle-même les « labels de récits transpersonnels ou encore d’ethnotextes ».
Ce serait en tout cas ainsi qu’Annie Ernaux qualifierait ses deux textes, Journal du dehors et La Vie extérieure. Dans ces deux ouvrages, Isabelle Charpentier nous dit qu’Annie Ernaux détourne délibérément la forme consacrée du journal intime : « Elle rapporte des faits bruts et des comportements sociaux banals saisis à la volée (…) ». Rapporter le fait brut. Tel serait donc le projet de l’écrivaine. Partant de là, vous comprendrez ce que cela peut donner quand il s’agit de rapporter le fait brut d’une première fois, et pas n’importe laquelle…
L’histoire en quelques mots
Ce livre est comme divisé en deux parties, entre les deux, il y a un événement, c’est ainsi que l’appellera Annie Ernaux (titre d’ailleurs de l’un de ses livres qui relate son avortement), pour nous, lecteur, c’est un coup de poignard, un basculement froid et glacial.
Dans la première partie on découvre une certaine Annie Duchesne, bientôt 18 ans, euphorique et impatiente de vivre une belle histoire d’amour dans une colonie de vacances où elle est animatrice. Très rapidement le rêve tourne au cauchemar tandis que le fait brut est dépeint sous nos yeux d’une façon presque chirurgicale.
C’est l’événement honteux de ce fameux été 1958 qui va bouleverser la vie d’Annie : c’est le viol d’une adolescente de 17 ans par le moniteur-chef.
Je m’arrête un temps là-dessus car bizarrement dans la plupart des émissions ou articles où ce livre a été évoqué lors de sa sortie en 2016, jamais il n’a été fait mention de ce mot… Peut-être parce que nous sommes un an avant que la bulle de savon #Metoo n’explose et que le tabou du viol n’en soit plus un, pour finalement envahir la place publique.
Quoiqu’il en soit, en 2016, et alors même qu’Annie Ernaux est invitée sur le plateau de la Grande Librairie, jamais le mot de viol n’est prononcé, il me semble pourtant que celui-ci est important pour bien comprendre les enjeux de la narration et de la mécanique du récit. Nous avons ici une victime de viol qui parlera de ce dernier comme d’un événement honteux.
Tel est le drame : c’est la victime qui éprouve la honte, une honte indélébile d’un acte vil et terrible dont elle n’est pas responsable. Ce viol marque à jamais Annie Duchesne, qui, dans la deuxième partie du récit, va donc devoir affronter les conséquences de cet événement : boulimie, dépression, kleptomanie…
Fragonard, Le Verrou, huile sur toile, 1774-1778. Paris, musée du Louvre.
Cette toile me fait un peu penser à notre œuvre. En effet depuis 2017, une nouvelle interprétation de ce tableau se fait jour… Et si, au lieu d’assister à une scène galante, comme on le prétend depuis des siècles, on assistait à un viol ?
Peut-on seulement écrire la honte ?
Telle est la question plus générale que j’aimerais aborder à travers cet article et précisément grâce à ce récit. Dans ce dernier, Annie Ernaux tente d’adopter un point de vue objectif, dénué de pathos et d’effets littéraires. Elle souhaite raconter les premiers émois sexuels à l’origine d’une honte sexuelle qui sera le moteur même de son projet d’écriture.
Transparaît déjà ici une dialectique entre cette volonté d’objectivité, à savoir, raconter le ‘fait brut’ et le sujet même de ce ‘fait brut’ qu’est la honte. La honte, par essence, ne peut être dite sans que la personne qui ait éprouvé ce sentiment ou cet état ne s’éloigne de la réalité vécue à l’instant T. De plus, si la honte a bien une particularité, c’est bien celle d’être cachée, in-dévoilable si je puis dire, au risque de n’être plus « honte » mais « revendication ».
La mémoire de la honte et l’écriture propitiatoire
En exergue de Mémoire de fille, on peut lire cette citation tirée du roman de Rosamond Lehman, Poussière, et qui illustre parfaitement le projet d’écriture d’Annie Ernaux :
La honte de sa faiblesse, de sa lettre, de son amour, continuerait de la dévorer, de la consumer jusqu’à la fin de sa vie. […] Tout cela, c’était l’expérience. C’était une chose salutaire. Elle pourrait écrire un livre maintenant (…).
Couverture du livre paru chez Libretto en 2009.
Ce n’est pas anodin si Annie Ernaux choisit non seulement cette citation mais aussi ce roman comme entrée dans son récit. L’héroïne, Judith Earle, est une jeune fille blessée, vouée à admirer et envier ceux qu’elle considère plus socialement élevés qu’elle, mais elle est surtout condamnée à la honte d’un amour dédaigné. En somme, Annie Duchesne est le pendant non fictionnel de Judith. Comme ce personnage fictif, Annie Ernaux est toujours habitée par cette honte juvénile qui la pousse, cinquante ans après l’événement honteux, à prendre la plume et à « écrire la honte ». C’est ce que l’auteure appelle :
La grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n’importe quelle autre. Cette mémoire qui est en somme le don spécial de la honte.
[…]. Depuis vingt ans, je note « 58 » dans mes projets de livre. C’est le texte toujours manquant. Toujours remis. Le trou inqualifiable.
À la lecture de ces mots, il n’y a plus d’échappatoire possible : l’écriture semble être le seul exécutoire de la honte, un « geste [même] propitiatoire » comme elle le souligne dans les dernières pages de son récit. L’utilisation de ce terme sacré, faisant référence à l’offrande faite aux dieux, montre l’importance de l’écriture comme si Annie Ernaux sacrifiait sa honte sur l’autel de l’écriture.
Faire œuvre de vérité
Pour parler de cette honte intime, Annie Ernaux tente de contextualiser son récit autant qu’elle le peut. Il s’agit pour elle de faire œuvre de vérité en donnant un cadre social et historique propice à la vraisemblance. Plus il y a de détails autour d’une histoire plus celle-ci semble vraie, en rhétorique et argumentation cette logique de persuasion est apparemment imparable !
Nous sommes donc à l’été 1958 dans une situation politique particulière puisque depuis mai le Général de Gaulle est de retour au pouvoir et la présence de l’armée française en Algérie est plus que jamais active.
Le 4 juin 1958, de Gaulle dit aux colons d’Alger : « Je vous ai compris. »
Ce qui contribue encore davantage à la vraisemblance du récit reste la description de la mentalité de l’époque. L’auteure brosse un tableau sociologique et social ciselé de ces jeunes filles fraîchement sorties de pension et prêtes à faire leur première fois. Ce sujet tabou, justement parce qu’il est tabou, occupe davantage l’imagination des adolescentes comme en témoigne cette réflexion d’Annie Ernaux :
[Faire l’amour] le grand secret chuchoté depuis l’enfance mais qui n’est alors ni décrit ni montré nulle part ? Cet acte mystérieux qui introduit au banquet de la vie, à l’essentiel – mon Dieu, ne pas mourir avant – et sur lequel pèsent l’interdit et l’effroi des conséquences.
En décrivant les déterminations psychologiques et sociales, l’auteure parvient à peindre le profil même de celle qu’elle était en rentrant à la colonie. Elle s’appuie également sur des documents comme le registre de l’aérium de S (sa pension) ou sur des lettres envoyées à ses amies pour raconter son histoire et donner au lecteur l’impression qu’il a face à lui un témoignage voire un documentaire.
Être crue pour être crédible
Annie Ernaux, en décidant de parler de sa honte intime, veut décrire au mieux ce qui lui est arrivé. Pour être la plus objective possible et donc la plus vraie possible, l’écrivaine choisit de mettre à distance de manière évidente et formelle la jeune fille de 1958 qui a vécu l’événement honteux. Elle parle justement de cette recherche stylistique lorsqu’elle écrit :
(…) Dois-je fondre la fille de -58 et la femme de 2014 en un “je” ? Ou ce qui me paraît, non pas le plus juste – évaluation subjective – mais le plus aventureux, dissocier la première de la seconde par l’emploi de “elle” et de “je”, pour aller le plus loin possible dans l’exposition des faits et des actes.
Cette troisième personne du singulier, utilisé surtout dans la première partie de l’ouvrage, est un parti pris qui semble nécessaire à l’écrivaine pour décrire les événements vécus afin de n’être pas à nouveau happée par ce qui lui est arrivé et pour saisir au mieux la psychologie qui était la sienne cinquante-cinq ans plus tôt. C’est d’ailleurs pour cela qu’Annie Ernaux tarde à nous décrire les événements concrets de cet été 1958 comme s’il lui fallait “créer son profil” le plus minutieusement possible.
L’écriture blanche – qualifiée de minimaliste voire de neutre par les théoriciens – sert également ce projet de véracité psychologique. Il s’agit de décrire la première nuit avec H de la manière la plus objective possible, sans pathos ni fioriture stylistique. Les phrases sont lapidaires et au temps du présent comme pour exposer de façon nette et crue le choc de la réalité.
Il force. Elle a mal. Elle dit qu’elle est vierge, comme une défense ou une explication. Elle crie. Il la houspille.
Le lecteur, assimilé à un spectateur-voyeur, ne peut que se rendre compte qu’il assiste à ce moment même à une atroce scène de viol. Le mot n’est jamais employé mais le choix de cette écriture tranchante vaut toutes les définitions.
Pourtant, cette mise à distance du sujet via la 3ème personne du singulier et l’écriture blanche semble menacer la part autobiographique du récit et la description même de la honte qu’a vécue Annie Ernaux. Cette dissociation ne montre pas tant la vérité objective de ce qui s’est passé (en tant que fait pris indépendamment de l’auteure) que l’impossibilité pour quelqu’un d’écrire sa propre honte.
Une impossible cohérence de la figure de l’auteure
Dans la première partie du récit, il semble plus que jamais difficile à Annie Ernaux de garder une distance par rapport à son propre personnage. Tandis que les allers-retours entre le passé et le présent de l’écriture constituent la matière première du récit, l’auteure nous signale à maintes reprises son incapacité à continuer l’écriture, repoussant sans cesse le moment où elle devra faire entrer Annie Duchesne dans l’espace de la colonie :
Je suis en proie à un accès de torpeur qui présage souvent un renoncement à écrire devant des difficultés que je ne définis pas clairement.
Cette réticence à entrer dans la chronologie des faits, loin d’être causée par un manque de mémoire, est au contraire dû à l’afflux trop nombreux des images qui envahissent l’auteure. On constate ici à quel point Annie Ernaux essaye en vain de mettre à distance la jeune fille de 1958.
Dès lors, la 3èmepersonne du singulier devient un leurre qui ne trompe personne… Effet stylistique superfétatoire qui, loin de permettre l’objectivité de l’auteure, accentue au contraire toute la tension entre les deux figures, celle du personnage et celle de l’auteure. Voilà tout le paradoxe de ce récit qui voudrait nous faire croire à un effet de dédoublement permettant l’objectivité de l’écrivaine sur ce qui lui est arrivé.
Cette fille-là de 1958, qui est capable à cinquante ans de distance de surgir et de provoquer une débâcle intérieure, a donc une présence cachée, irréductible en moi.
[…]
Je ne pénètre plus la pensée de la fille de S, je ne peux que décrire ses gestes, ses actes, consigner les paroles, celles des autres et plus rarement les siennes.
Une nécessaire fictionnalisation de l’événement honteux ?
Nous l’avons vu, le sentiment de la honte est tenace ou du moins reste-t-il latent de sorte que, même des années plus tard, il peut resurgir et envahir son propriétaire. La mise à distance par l’écriture engendrant une sorte de fictionnalisation de l’événement honteux, pourrait être une solution pour écrire la honte. Mais à quel prix ? Annie Ernaux en tentant d’objectiver sa honte et de mettre à distance son propre personnage de victime, ne laisse que peu de place au lecteur pour interpréter, vivre et ressentir le récit.
Si seulement nous avions suivi le parcours d’Annie Duchesne en tant que simple spectateur-voyeur, peut-être aurions-nous pu adhérer au pacte de lecture et comprendre que l’enjeu ici n’était pas tant l’identification à un personnage que la réception d’une tragédie sur laquelle nous n’avions rien à dire, mais Annie Ernaux revient sans cesse au présent de l’écriture et souligne à quel point elle n’a plus rien avoir avec cette fille de -58.
C’est ainsi que, dans la première partie de son livre, surtout, nous avons la fâcheuse impression d’être constamment manipulé. Le comble de l’horreur arrive lorsque l’écrivaine use de processus très visuels et typographiques pour mettre à jour une prétendue distanciation comme c’est le cas lorsqu’elle écrit cette phrase lapidaire introduite par le déictique et entourée d’espaces blancs de part et d’autre de la ligne :
Voilà la fille qui va entrer à la colonie.
Où donc se placer en tant que lecteur dans ce récit littéraire ? Faut-il se détacher de la figure autobiographique pour accéder pleinement à la compréhension d’une honte intime qui pourrait être la nôtre ? Mais peut-on vraiment, comme Annie Ernaux, parvenir à fictionnaliser cette honte et à nous identifier au personnage principal ? Mais avons-nous seulement dans Mémoire de fille, une véritable fictionnalisation ?
La fille de la photo n’est pas moi mais elle n’est pas une fiction.
Photographie d’Annie Duchesne en février 1958.
Cela devient compliqué… Annie Ernaux ne veut pas fictionnaliser cette jeune fille mais elle ne veut pas non plus en parler comme si c’était elle. Elle lui crée donc une existence indépendante. Mais comment l’auteur, celui qui doit “être présent partout, visible nulle part” selon Flaubert, omniscient et en même temps devant faire comme s’il ne savait rien, peut-il adopter cette posture lorsqu’il raconte une tranche de vie qui est la sienne ? Annie Ernaux semble en effet concilier difficilement cette posture car elle revendique à la fois une distanciation par rapport à l’événement honteux qu’elle voudrait exorciser et à la fois elle semble toujours rattrapée par la subjectivité et l’intimité de cet événement honteux qui ne lui appartient qu’à elle. Elle se trahit elle-même en écrivant :
L’idée que je pourrais mourir sans avoir écrit sur celle que très tôt j’ai nommée “la fille de 58” me hante. Un jour il n’y aura plus personne pour se souvenir. Ce qui a été vécu par cette fille, nulle autre, restera inexpliqué, vécu pour rien.
L’imbrication entre les deux entités est plus que visible : il y a “cette fille”, presque objectivée et prise comme objet d’étude, mais il y a aussi cette écrivaine qui se souvient et a besoin d’écrire une expérience propre et vécue par elle seulement.
L’inévitable reconstruction du réel par l’écriture
Au cas où vous ne l’auriez toujours pas compris, écrire la honte, et encore plus sa propre honte, est difficile. Annie Ernaux essaye le processus de mise à distance du sujet. Ce faisant, elle s’éloigne du récit autobiographique pour être au plus proche, selon elle, de la réalité de l’événement honteux. Toutefois, quand bien même elle aurait voulu respecter entièrement le pacte autobiographique, soit l’authenticité, l’écriture, parce qu’elle use des mots, aurait reconstruit le réel et l’aurait à nouveau nécessairement modifié. Même dans le récit autobiographique où je raconte le “ça a eu lieu”, ce “ça a eu lieu”, reconstruit par l’écriture, s’éloigne forcément de la vérité et donc de la réalité vécue singulièrement. On a donc une reconstruction du réel par la mise en mots et la mise en image qui suit nécessairement la lecture.
Il devient dès lors difficile de parler avec justesse d’un sentiment ou d’un état tel que la honte. Annie Ernaux dit elle-même peiner à circonscrire son sujet. Elle fait des suppositions quant à l’état d’esprit de son homologue mémoriel, elle modalise ses propos, emploie des verbes tels que “il me semble” ou encore “peut-être” comme si elle ne parvenait pas à comprendre cette jeune fille qui n’est autre qu’elle-même. Mais en parallèle, Annie Ernaux, accompagne son personnage et lui prête des intentions et des réflexions qui ne peuvent que nous faire comprendre à quel point la figure de l’auteur loin d’être visible nulle part, est visible partout. Elle dit par exemple de cette jeune fille de 1958 :
Sa vie la plus intense est dans les livres dont elle est avide depuis qu’elle sait lire. C’est par eux et les journaux féminins qu’elle connaît le monde.
L’écho est tout de suite établi entre Annie Duchesne et le personnage de Madame Bovary. Nul doute qu’ici c’est bien le bagage littéraire de l’écrivaine qui ressurgit à travers l’écriture. Le fait littéraire vient transformer nécessairement le matériau du réel à partir duquel on écrit. Il semble dès lors impossible pour l’auteure d’écrire de façon honnête et authentique la honte sans trahir les sentiments de celle qui a vécu la honte des années plus tôt. La honte deviendrait alors un obstacle à l’écriture de soi et même un obstacle à l’universalité visée à travers la littérature.
Jennifer Jones interprétant Madame Bovary en 1949.
Peut-on donc concilier récit autobiographique et mémoire de la honte ? La honte doit-elle n’être racontée que par ceux qui ne l’auraient pas vécue personnellement, la fixant donc à jamais dans le récit purement fictionnel, seul moyen de toucher à l’universalité ? Peut-être faudrait-il seulement laisser au témoignage l’apanage du récit de la honte vécue et personnelle, comme cela peut être le cas dans les témoignages des déportés ? Peut-être le problème réside-t-il seulement dans la distinction même que l’on peut faire entre l’événement honteux (qui ne peut être partagé, car vécu singulièrement par une personne) et le processus ou mécanisme de la honte, qui, pour le coup, peut-être davantage circonscrit et compris par une communauté de personnes ayant ressenti ou éprouvé la honte ?
L’événement honteux : un objet littéraire difficile à circonscrire
En dissociant l’événement, qui est à l’origine de la honte, d’avec le mécanisme même de la honte, peut-être pouvons-nous réussir à résoudre la posture complexe et parfois paradoxale de la figure d’auteur d’Annie Ernaux dans son récit. En effet, tout au long de la première partie, quand cette dernière tente de nous raconter de la manière la plus objective possible semble-t-il, ce qui est à l’origine de la honte, le lecteur trouve difficilement sa place.
Son espace d’interprétation et d’imagination est limité, il ne peut juger ou même comprendre ce qu’on lui donne à lire puisque tout lui est donné de manière brute et directe comme s’il lisait le journal intime d’une personne.
Paradoxalement la distanciation et l’effet miroir mis en place par Annie Ernaux nous donnent comme la permission voire la légitimité de lire ce journal intime. De fait, n’est-ce pas l’auteure elle-même qui nous introduit à un épisode de sa vie qu’elle accepte de partager ? Pourtant, ce n’est qu’après la lecture entière du récit que nous acceptons notre position de voyeur lors de la première partie.
Parce qu’Annie Ernaux raconte un événement qui lui est arrivé à elle et à elle seule, le lecteur n’a aucune clef pour véritablement comprendre la psychologie de celle qui a vécu l’événement. L’expérience singulière nous échappe toujours, elle est vécue par un seul être.
L’objet littéraire n’est pas dans la narration même de ce ‘viol’ auquel le lecteur assiste, il est dans la manière dont cet événement va se répercuter sur la vie et la personnalité de la victime. Aussi, Annie Ernaux trouve-t-elle peut-être finalement la manière la plus juste pour raconter l’événement honteux.
Grâce à cette narration à la troisième personne et à cette écriture blanche, elle tente d’être au plus près de la vérité qui veut justement qu’aucune personne ne puisse comprendre ou vivre par intermédiaire ce qu’une seule personne a vécu à l’instant T. L’écrivaine se met en position de recul par rapport à celle qu’elle est au moment de cette nuit avec H, car on ne revit jamais exactement ce qu’on a vécu au moment où l’événement a eu lieu. Elle écrit très justement :
Ni soumission, ni consentement, seulement l’effarement du réel qui fait tout juste se dire « qu’est-ce qui m’arrive » ou « c’est à moi que ça arrive » sauf qu’il n’y a plus de moi en cette circonstance, ou ce n’est plus le même déjà.
Edgar Degas, L’Intérieur ou Le Viol, huile sur toile, 1868-1869. Philadelphie, Museum of Art.
Cette scène a été interprétée comme étant une douloureuse nuit de noce dans l’un des romans d’Émile Zola.
Le mécanisme de la honte : le véritable objet universel et littéraire
Finalement ce qui fait écho chez le lecteur à travers cette lecture de Mémoire de fille, c’est le mécanisme, souvent implacable, de la honte. En mettant sciemment ou non une barrière entre la fille de S et elle, Annie Ernaux dévoile le fonctionnement de cette machine autodestructrice qu’est la honte : cette volonté de renier la personne que l’on était au moment où notre ego idéal a déchu.
On parle de la « mémoire de la honte », mais il faudrait également parler de la « mémoire du honteux », de celui qui a été objectivé. La blessure, en lui, est indélibile et c’est en vain que le honteux essaiera de chasser celui ou celle qui a vécu l’événement honteux. Ce dernier fera à jamais partie de nous, pour le pire ou le meilleur. Chez Annie Ernaux, c’est parce que cette fillette de -58 a persisté en elle qu’elle éprouve le besoin d’écrire sur elle cinquante-cinq ans plus tard.
Il me semble que j’ai désincarcéré la fille de 58, cassé le sortilège qui la retenait prisonnière depuis plus de cinquante ans dans cette vieille bâtisse majestueuse.
Ces paroles arrivent au milieu du livre, une fois qu’Annie Ernaux a fait face à l’événement originaire de sa honte. Cette citation se termine d’ailleurs sur une réconciliation des ‘moi’ d’Annie Ernaux :
Je peux dire : elle est moi, je suis elle.
Dans la deuxième partie du roman, le lecteur semble reprendre plus aisément sa place. Il suit l’évolution de la douleur que cause la honte, il suit les affres mais aussi la renaissance partielle d’une jeune fille blessée. C’est là qu’Annie Ernaux atteint l’universalité et qu’elle parvient à réconcilier son œuvre avec le but de toute littérature : parler à tous. Petit à petit, Annie Ernaux reconquiert sa fierté voire son être. Le ‘elle’ est toujours de mise mais s’efface peu à peu. Un pronom possessif affleure par ci par là et finalement ce n’est qu’aux dernières pages du récit qu’Annie Ernaux nous montre sa renaissance grâce à la littérature. Elle réconcilie les deux Annie, celle qui a vécu à Ernemont les pires années de sa vie et celle qui épouse un certain Philippe Ernaux. Deux noms, de même origine germanique, qu’elle voit comme un signe mystérieux, celui peut-être d’une réunion de la fille de 58, à qui elle doit toute sa vocation littéraire, et de la femme de 2014, écrivaine accomplie, l’important n’étant pas ce “
qui arrive mais [c’est] ce qu’on fait de ce qui arrive”.

Mise en scène de Mémoire de fille au théâtre de Namur en 2020. Photo de Thomas Faverjon.
Mémoire de fille ou le roman d’éducation 2.0
Ce texte hybride, affublé du genre ‘récit autobiographique’ n’est donc pas tant à considérer sous l’angle d’une véracité ou d’une authenticité propre aux autobiographies. Contrairement à Rousseau qui revendique dans ses Confessionsce désir de nudité face au lecteur, Annie Ernaux ne revendique jamais une quelconque volonté de véracité autobiographique. Elle écrit même :
Ce n’est pas la réalité de mon histoire avec H que je veux raconter, c’est une manière de ne pas être au monde – de ne pas savoir s’y comporter.
Qu’Annie Ernaux cherche les effets stylistiques tout en niant vouloir le faire ne nous intéresse finalement pas autant que le dévoilement des mécanismes de la honte qui peuvent universellement être partagés à travers son texte. Considérer, comme elle le souligne, cette possibilité qu’on a de ne plus “être au monde” à cause de la honte. D’ailleurs Annie Ernaux, nous dit qu’elle aurait pu écrire d’une toute autre manière ce récit, “comme un rapport de faits bruts”, les ressources littéraires étant nombreuses.
Qu’il y ait ré-écriture de soi nous importe peu, d’autant plus que même dans une autobiographie qui voudrait respecter le pacte de lecture, il y a toujours un écart entre la réalité et les mots. Ce qui compte ici c’est la recherche dont parle Annie Ernaux elle-même, transposant dans l’écriture, l’attitude que les gens ont dans la vie réelle concernant leur honte. Elle radicalise par le ‘elle’ ce que nous faisons dans la vie en disant ‘j’ai changé’, ‘je ne suis plus le même’, et finalement l’identification opère, de sorte que certains lecteurs pourraient presque faire le parallèle entre le récit autobiographique d’Annie Ernaux et les romans d’éducation. Dans les deux cas, nous avons l’évolution d’un personnage, construction et achèvement.
Conclusion
Un texte de sociologue peut être efficace pour comprendre les mécanismes de la honte, le témoignage d’une victime de viol peut être assez poignant et terrible pour permettre une meilleure prise de conscience. Certes, mais n’oublions pas que la littérature est aussi source de bienfaits. Parce qu’elle est une forme de langage et non une science fondée sur des preuves, la littérature a la vocation de toucher n’importe quel destinataire. C’est justement comme dit Annie Ernaux “l’absence de sens de ce que l’on vit au moment où on le vit qui multiplie les possibilités d’écriture”.
La littérature n’est pas une science, elle vit, elle est libre et c’est ce que ce texte d’Annie Ernaux nous prouve en parlant de ce sentiment qu’est la honte. Parler de la honte est donc difficile, écrire dessus l’est encore plus mais peut-être est-ce finalement aussi le meilleur moyen d’en comprendre les tenants et les aboutissants sans toutefois imposer un schéma structurel, vide d’émotion et d’expérience, ou au contraire l’implacabilité du choc d’un témoignage. La littérature, comme moyen thérapeutique de la honte ? “C’est peut-être la plus grande vérité de ce texte” pour reprendre les mots de l’auteure.
Annie Ernaux par Jean-Luc Bertini.