
Peut-être suis-je biaisé, mais il ne me semble pas faire un pari risqué à dire que la figure du révolté, culturellement, est plutôt sympathique et populaire. Je n’ai qu’à fermer les yeux pour que bondisse le James Dean de Rebel Without a Cause, que Robin des bois tombe d’un arbre ou Gavroche le nez dans un ruisseau.
Encore s’agit-il de représentant masculins, même si, spécificité française ? une Marianne au sein nu continue de guider le peuple – il me plaît d’y voir un renversement symbolique de l’image du dieu ou du héros qui poursuit la femme-proie.
Sans doute aimons-nous plus le mythe de la révolution que ses manifestations concrètes et ses errances ; sans doute, animaux raisonnables et un poil sophistes, nous figurons-nous que nous serions prêts nous aussi à monter sur quelque barricade glorieuse à condition que la cause fût juste et, naturellement, à la hauteur de notre intelligence pénétrante.
Or, et c’est une leçon de George Orwell, de sa novlangue et de ses cochons « égalitaires », le ver est dans le fruit du discours qui promet des lendemains qui chantent. Le serpent diabolique a la langue trop bien pendue pour ne pas susciter la méfiance (l’intrus de Roger Corman en sait quelque chose !).
Aussi les révoltes qu’elle paraissent douces ou violentes sont-elles l’occasion de tensions entre, d’une part, les orateurs qui s’efforcent de construire un mythe unifiant et moteur de l’action, et d’autre part les acteurs que les discours stimulent ou irritent rapidement. Les uns et les autres peuvent échanger leurs rôles, certes, mais la tension demeure.
Ce qui fait tenir une révolte, ou un état tout aussi bien, tient peut-être à un cheveu ou à un acte de foi, ce dernier permettant à l’individu d’entretenir au cœur de la multitude un mirage qui le motive. Le problème, bien entendu, c’est qu’il n’y a pas de « der des ders », et qu’on survit aux guerres mondiales comme aux révolutions qui échouent.
Il se pourrait bien qu’échecs et désastres méritent eux aussi leur discours.
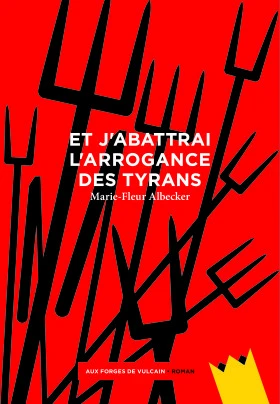
Et j’abattrai l’arrogance des tyrans – Marie-Fleur Albecker – solitude de la prophétesse
Le roman Et j’abattrai l’arrogance des tyrans de Marie-Fleur Albecker traite donc, ce n’est pas gâcher l’histoire de le dire, d’une révolte de paysans anglais qui eut lieu en 1381 et fut écrasée dans le sang. Cependant, comme nous l’apprend le résumé, le point de vue privilégié ici est celui de Johanna, paysanne qui s’évertue à exprimer, par la voix et par le geste, les particularités de son sentiment de révolte parmi une foule quasi exclusivement masculine.
Je laisse la parole à l’autrice [2] qui l’explique forcément mieux que moi : Marie-Fleur Albecker présente son roman en vidéo pour la libraire Mollat.
J’en profite pour rappeler ici que les éditions Aux Forges de Vulcain, qui publient ce roman, publient aussi votre serviteur, donc n’attendez aucune objectivité de ma part. Précisons aussi que le roman est disponible en poche dans la collection Points depuis le 5 mars 2020 !
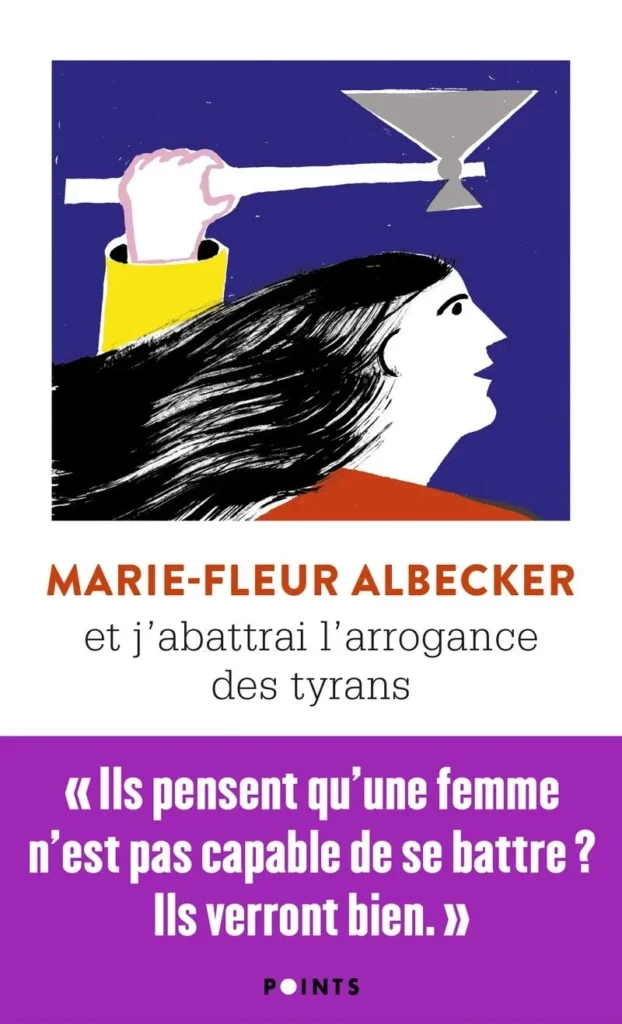
« Hors du trône, tyrans ! à la tombe, vampires ! » [1]
La révolte donne, nécessairement (?), l’impression d’une force chaotique en mouvement, que contribuent à faire expérimenter au lecteur les variations de niveau de langue et de registres de langage dans le récit, ainsi que d’autres choix formels.
On voit ainsi surgir en pleine narration des commentaires sarcastiques, par exemple : « (tu parles !) (mon cul sur la commode) », le discours direct et/ou les italiques entretenant un doute sur leur provenance. S’agit-il de commentaires de l’auteur-narrateur sur les aléas de l’Histoire, des pensées de Johanna, d’une superposition des deux ?
De la même façon, le discours descriptif cède parfois la place au didactisme comique, donnant moins à voir qu’à informer, incitant à classer et trier plutôt qu’à s’immerger, d’autant que les anachronismes prolifèrent et rappellent à tout moment que les révoltés ont perdu, que le discours triomphant aujourd’hui est celui d’un après où n’a pas triomphé la vertu :
Et puis les dockers ont coûté cher, les quartiers donnant sur l’eau et proches des centres ont plu aux jeunes cadres dynamiques, et Mme Thatcher a inventé les quangos, ces entreprises ni publiques ni privées, mi-publiques, mi privées, et les quangos, pour la faire courte, ont érigé une forêt de pénis permettant à la finance de satisfaire son appétence pour les baies vitrées, les atriums démesurés à plantes vertes persistantes et les moquettes gris clair, tout en rationalisant les prix du foncier.
Atriums, quangos et pénis : puisque l’idéal de la révolte ne perdure pas, il s’agit de ne pas idéaliser les révoltés et de dénier, au moins temporairement, les illusions du lyrisme au lecteur qui chercherait dans le livre une belle histoire, un divertissement ou une diversion.
Car si le lecteur est en pantoufles et bien au chaud, ce qu’on lui souhaite, le constat pour les révoltés anglais de 1381 est assez bref : « Ainsi furent-ils tous détruits ». La distance critique imposée au lecteur pourrait donc bien être le meilleur moyen de le placer lui aussi dans la posture du vaincu, de l’inciter à la révolte.
Mais contre qui ou quoi : l’auteur démiurge un peu trop taquin, ou l’injustice mise en mots ? le monde inégalitaire du Moyen Âge reconstruit ou ce qu’il reflète des inégalités actuelles ?
C’est bien en tout cas la satire et la métafiction historiographique [3] qui domine le roman et le rattache au postmodernisme. Sans l’avoir lu moi-même, je renvoie sur ce sujet à L’Oeil de Carafa du collectif italien Wu Ming, qui est une des références de Marie-Fleur Albecker et qui est évoquée sur Charybde27.

« Et j’ai crié, crié » [4] : s’il ne doit en rester qu’un
Il faut rappeler ici que le titre en tant que tel du roman, Et j’abattrai l’arrogance des tyrans, est tiré de la traduction de la Bible par Louis Segond, et surtout d’un livre du prophète Ésaïe qui annonce la venue d’un messie, soit : l’espoir d’un changement pour le mieux.
Malgré les plaisirs de l’ironie et la volonté de distanciation, il arrive que quelque chose comme une prière ouvre grand la bouche. C’est notamment le cas avec la dernière partie du roman, qui débute par une citation de l’Ancien Testament :
Jusqu’à quand, ô Éternel ?… J’ai crié, Et tu n’écoutes pas ! J’ai crié vers toi à la violence, Et tu ne secours pas ! Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité, Et contemples-tu l’injustice ? Pourquoi l’oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles, et la discorde s’élève. Aussi la loi n’a point de vie, la justice n’a point de force ; Car le méchant triomphe du juste, Et l’on rend des jugements iniques.
Habacuc, 1, 2-4
Je me bornerai ici à remarquer qu’Habacuc est un prophète dont la caractéristique est d’interpeller Dieu et de contester son omnipotence, en particulier dans le passage cité. Dans cette logique, la prophétie du révolté, au lieu de chanter l’avenir heureux, est un constat d’incompréhension et d’impuissance. Car, après la révolte vaincue, « Ce fut alors comme si rien ne s’était passé. »
La narration fait écho à ce désarroi, reprenant les questions rhétoriques et les protestations du prophète, attribuant par glissement les qualités d’une prophétie au discours de la révoltée qui refuse le cours de l’Histoire et utilise encore le futur de l’indicatif : « C’est fini ? Mais non, ce ne sera jamais fini, on ne reviendra jamais de ça ! » [5]
Or la solitude est l’apanage du prophète, voué à annoncer et à donner à espérer un temps que lui-même il ne vivra pas, que peut-être son discours ne servira même pas à faire advenir. Le prophète, ou le visionnaire, est donc captif de son temps, et Marie-Fleur Albecker indique clairement que le fait d’être une femme amplifie le sentiment de solitude et de dépossession propre au révolté vaincu :
Elle était redevenue une femme, une quantité négligeable, un rien. Comme si tout glissait d’elle et de ses mains, ce qu’elle avait été, ce qu’elle ne serait pas.
Dans la défaite, la révoltée plus que tout autre a senti sa puissance, et comprend quels possibles ont disparu. Cela est d’autant plus prégnant que la révolte contre le roi est aussi révolte contre Dieu, dans la mesure où chacun est le garant de l’autre grâce à la continuité dynastique (ce qui explique d’ailleurs la valorisation exceptionnelle de certains souverains par le biais de la piété, que l’on songe par exemple à Saint Louis).
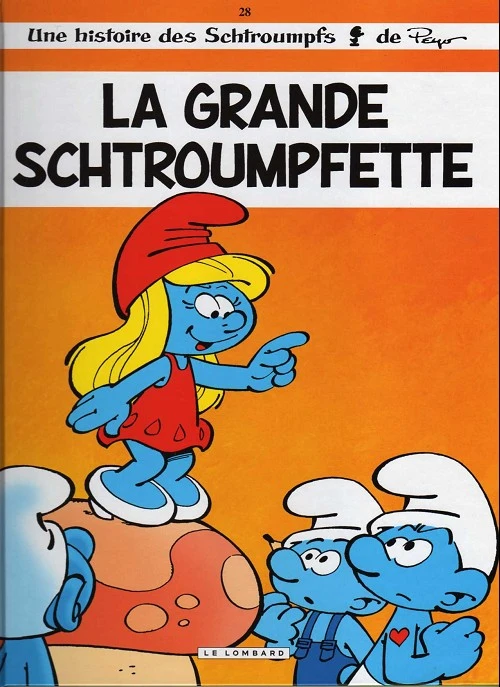
Consciente du potentiel sacrilège de la révolte, le personnage de Johanna se déclarait prêt à aller jusqu’au bout. Le sacrilège n’ayant pas eu lieu, les vaincus choisissent soit de combattre (trop tard, et donc en vain) jusqu’à la mort, soit de s’aveugler volontairement sur l’état du monde et le leur :
Les autres n’ont plus d’importance, car ils ne veulent plus regarder leur vie en face.
Renonçant à voir, les anciens révoltés aiguillonnent la mauvaise conscience de la visionnaire qui s’avère incapable de ne pas avoir vu. On peut à vrai dire considérer que, dans un renversement kafkaïen, les humiliés et les offensés écrasés s’efforcent de démontrer l’absurdité du discours de la révolte, ce qui implique de décrédibiliser la dernière révoltée par des disputes successives :
De violentes disputes en fait ; elle se voyait reprocher son impulsivité, son manque de réalisme (attributs, on ne manquait pas de lui signaler, typiquement féminins), l’inutilité de tels raisonnements alors qu’elle aurait mieux fait de chercher à se remarier (car un pénis, c’est bien connu, calme les ardeurs d’une femelle hystérique), de passer à autre chose. Jamais ! répondait-elle. C’est très bien, lui disait-on, d’avoir des idéaux dans sa jeunesse, mais après il faut vivre dans le monde, car c’est ce qui nous est donné. Et le monde d’après ? s’écriait-elle. Il vous rattrapera un jour ! Elle ne sait même pas si elle y croit encore. […] La rage lui coûte trop, elle s’est laissé couler dans un monde d’hébétude, vide de sens et de fureur.
Dans un monde où l’action (violente) n’est plus acceptable, le discours du prophète l’exile [6] au moins dans son for intérieur, retournant contre lui-même sa rage privée de cible. Or dans sa sincérité, la révoltée vaincue est contrainte de lier le sens de la révolte au sens de la vie, d’opposer la puissance signifiante du mouvement collectif au dérisoire de la conscience individuelle.
C’est alors Dieu (dans le contexte médiéval du roman, mais on pourrait dans un contexte contemporain le remplacer par l’État, la démocratie…) qui est remis en cause par la prophétesse survivante :
La vengeance personnelle est bien peu de chose quand on a combattu pour modifier l’entièreté du monde, et que continue à tourner la ronde des puissants, ceux qui se reconnaissent et s’auto-congratulent tandis que le peuple reste à sa place. […] Rien, rien ne change. […]
Elle est déjà morte, et elle craint désormais la mort, quand son corps disparaîtra, car si eux, les rebelles, qui portaient en eux l’espoir de la vraie Justice, ont été défaits si facilement, n’est-ce pas que Dieu n’existe pas ? Ou qu’il est mauvais ? Alors il n’y a soit rien, soit une éternité d’inconséquence et d’injustice. Le monde n’a plus de sens.
Dieu faillible est une image de la révolution avortée. Crise partagée par un collectif, la révolte qui a échoué n’est pas tant un retour à la normale qu’un purgatoire où l’individu, tel un amoureux endeuillé, est déchiré entre un passé devenu récit l’échec et un avenir qui n’en sera que la reformulation incessante.
C’est, évidemment, un point de vue pessimiste, mais le récit de l’échec a valeur d’avertissement, en même temps qu’il oppose aux deux corps du roi le double fardeau d’une femme dont la révolte n’a pas pu s’exprimer jusqu’à son terme :
c’est fini pour elle, elle qui souffre le double fardeau de l’idéal pour lequel elle s’est battue et d’une révolte de femme qui paraît absurde à tous ceux qui l’ont entendue.
Le contrat entre auteur et lecteur est alors réaffirmé, le premier invitant l’autre à entendre (comprendre), sans savoir si sa vision sera partagée ou si la fin du livre est, tragiquement, la fin d’une espérance.
Note :
[1] Victor Hugo, La Légende des siècles, « Éviradnus »
[2] J’en entends qui convulsent. Serrez les dents, ça va passer : c’est dur que les premiers siècles.
[3] Soit une fiction qui se montre pour telle, et qui ne prétend pas à la neutralité dans sa façon de présenter l’histoire.
[4] Christophe, Aline. Vous voyez ? C’est un peu ça, le postmodernisme.
[5] À tort ou à raison ce refus me renvoie à L’Homme révolté de Camus : « Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. »
[6] Et je pense de nouveau à Victor Hugo, volontiers prophète en discours, exilé volontaire dont le recueil de poèmes Les Châtiments condamna en discours Napoléon III.
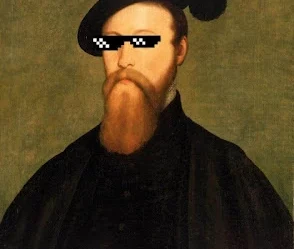


*convulse